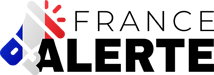C’est un concept, Ours. Si son premier album paru en 2007 s’intitulait Mi, c’est parce que le deuxième publié quatre ans plus tard s’est appelé El. Les esprits les plus finauds, enfin ceux qui ne suivent pas les cours scotchés au radiateur, auront relevé l’astuce : Mi + El = Miel. Quoi de plus évident quand on a choisi un tel nom de scène. Longtemps, l’animal a veillé à se tenir éloigné de son géniteur. On savait bien que, sous le nom de Charles Souchon, il avait conçu le site internet de son père, mais par le truchement de son drôle de patronyme au parfum pyrénéen, il évitait d’être associé à cette encombrante parenté. Jusqu’à ce qu’il collabore au quinzième album d’Alain Souchon, Âmes fifties (2019), et qu’il enchaîne avec une tournée familiale entraînant le père et ses deux fistons sur les routes.
Ainsi, détendu face au chêne dont il pouvait redouter l’ombre, le dénommé Ours put enregistrer son cinquième album en toute décontraction. Composé de onze titres, Le Spleen d’une vie sublime est un joli objet s’imposant dans une veine artisanale laissant une légère mélancolie d’enfant sorti de sa sieste ou d’une courte période d’hibernation. Le timbre, légèrement froissé, témoigne en toute humilité de tendres inquiétudes, joliment troussées. Mais ne vous fiez à leur air innocent : ces ritournelles finissent bien par vous entrer dans la tête. Car même les ours savent planter des clous.
Le JDD. Comment l’idée de ce titre, Le Spleen d’une vie sublime, vous est-elle venue ?
Charles Souchon, alias Ours. En observant mes parents. Parfois, je perçois un petit sourire teinté de mélancolie quand ils évoquent le passé. Ils se disent : « Qu’est-ce que c’était bien quand même ! » tout en sachant que ce temps est bel et bien révolu. Ce genre de petit coup de mou, j’ai aussi pu le ressentir lors de mon passage à la quarantaine. Je me penche en arrière et je mesure la chance que j’ai eue de vivre une telle enfance et une telle adolescence tout en sachant qu’elles ne reviendront pas. Matthieu Chedid en a fait une chanson, Nostalgique du cool. J’aime ce genre d’oxymores.
Le passage à l’âge adulte est-il d’autant plus éprouvant qu’on a vécu une enfance heureuse ?
La suite après cette publicité
La mienne a été exceptionnelle et m’a permis d’exaucer un rêve que je continue de nourrir : celui de vivre de ma passion en faisant de la musique tous les jours. Quand j’y repense, ce sont des images liées au monde du spectacle qui me reviennent, baignées de fantaisie. Je me revois en train de traîner dans les coulisses du Casino de Paris ou de l’Olympia alors que les musiciens effectuent leurs balances. Ça joue, ça rit. Avec le recul, j’ai bien conscience qu’une telle enfance était décalée par rapport aux gamins de mon âge : pour moi, la journée commençait lorsqu’elle est censée s’arrêter pour un garçon qui va à l’école.
À 18 heures, je sentais monter une effervescence, on se préparait tous pour aller au concert. Quand mes petits camarades se mettaient au lit, moi, j’applaudissais mon père qui brillait de tous ses feux sur scène. Et la soirée était loin d’être terminée : plus tard, il y avait les dîners d’après-concert à la maison. À nouveau, c’était toujours très joyeux : j’entendais leurs rires jusqu’au fond de mon lit. J’aimais cette atmosphère, être baigné de toute cette sensibilité de faiseur de chansons.
Faisiez-vous déjà de la musique avec votre frère, Pierre ?
Non, contrairement à ce que l’on pourrait supposer. Même si Pierre fait très jeune pour son âge, nous avions trop d’écart pour jouer ensemble : quand j’avais 6 ans, il en avait déjà 12. Mais c’était mon grand frère et je l’admirais. Je le voyais jouer du piano, de la batterie et j’arrivais toujours à me faire une petite place quand il répétait avec ses groupes. Il collaborait à l’époque avec Matthieu Chedid et Mathieu Boogaerts. J’essayais de me rendre utile en les aidant à monter une estrade ou bien en m’improvisant « monsieur Loyal » pour présenter leurs spectacles.
Quand on écoute votre album, on sent d’ailleurs une influence très claire de Mathieu Boogaerts dans la manière que vous avez de produire vos mélodies dans un minimalisme en lignes claires…
Il est vrai que mes chansons possèdent toutes un côté bricole. Cela tient au fait que j’essaie d’en mettre un minimum dans mes orchestrations afin qu’elles puissent respirer. Dans ce disque particulièrement, j’ai tenu à être sur un fil pour ne pas perdre l’émotion première du piano-voix. Je me suis même risqué à aller dans des tonalités qui m’étaient moins confortables pour préserver une forme de fragilité. C’est le cas de la chanson « Aigu », une des premières que j’ai maquettées.
En plus d’être musicien, vous êtes graphiste. Est-ce que cette formation aux arts visuels vous aide ?
Oui, sans doute. Après des études au Chelsea College of Art and Design, j’ai suivi un cursus à Camberwell. Même si je ne l’ai jamais conscientisé, je mesure que toutes ces notions que j’ai apprises lors de mes études d’art en Angleterre me servent encore pour construire mes morceaux.
Comment procédez-vous ?
Longtemps, les textes me venaient en même temps que les musiques. Je pouvais forcer les mots afin qu’ils s’emboîtent dans la mélodie. Pour cet album, j’ai pris une résolution ferme et définitive : « Non, les mots sont chefs : ce sont eux qui font la loi ! » Tant que je n’avais pas un angle de texte, je me refusais à composer la moindre note. Mais j’ai la prétention de penser que les musiques me viennent plus facilement, et souvent à vélo, comme ce fut le cas pour « Aigu » ou « À quoi tu penses ? »
« Pas sûr que mon père ait encore la niaque pour un autre disque »
À ses débuts, votre père a été qualifié de nouvel homme fragile. Et voilà que vous enregistrez une chanson qui s’intitule « Pleure comme un homme ». C’est dur d’être fragile ?
Oui. Et je suis bien placé pour le dire. Je n’ai pas versé la moindre larme depuis l’âge de 12 ans ! Je ne sais pas pourquoi, ça ne me vient pas. Pourtant, je sais que c’est bon pour la santé, une sorte de merveilleux exutoire. Mais non, ça ne me vient pas ! Et mes copains se chargent bien de me le rappeler. Dernièrement, j’assistais à l’enterrement d’un ami très proche. J’avais beau être triste comme les pierres, rien ne coulait. Je les entendais me sermonner alors que le cercueil passait devant nous : « Mais t’es fou, garçon ! Il faut pleurer ! » Eh bien non, je n’y arrivais toujours pas. Et pourtant, rien ne m’émeut plus qu’un homme qui pleure. Quand je vois les héros du Vendée Globe rentrer aux Sables-d’Olonne après avoir surmonté les pires épreuves, je suis bouleversé par ces images d’hommes épuisés qui fondent en larmes devant les caméras du monde entier.
Votre prochain défi : devenir marin !
J’ai déjà l’impression de l’être un peu : ça fait quatre mois que je n’ai pas dormi plus de deux jours au même endroit. Actuellement, je suis sur les routes avec mon père et mon frère. Quand on part en tournée, on a l’impression d’être un capitaine à bord d’un bateau. Marin, c’est nourrir le fantasme du type qui dit : « Adieu, société, je pars à l’écart du monde pour méditer. Je serai de retour dans quelques semaines. » Mais il revient toujours !
Mais quand on est héritier d’une lignée si marquée, peut-on vraiment s’en échapper ? Sur votre disque, le duo avec votre père est-il un passage obligé ?
Non. Et pour être franc, je ne pensais pas l’inviter sur le disque. Ça fait dix ans que je refuse tous les sujets, toutes les émissions, toutes les photos avec lui pour ne pas donner l’impression d’être dans ses pattes. Puis, on a fait Le Soldat rose et la fabrique de jouets (2017) ensemble et participé à la musique du film Ouvert la nuit d’Édouard Baer (2016). Ça s’est tellement bien passé qu’on a fait le disque de notre père, Âmes fifties (2019), Pierre et moi. Cette chanson, « À quoi tu penses ? », était à l’origine prévue pour notre tournée commune : on se disait que ça serait bien qu’on ait un morceau à nous. J’avais pensé, encore une idée qui m’est venue à vélo, à quelque chose qu’on pourrait interpréter à trois. Et cette phrase est un bâton de relais, comme un passage de témoin. Mais mon père a tellement de tubes dans sa setlist qu’on n’a jamais pu la jouer. Je trouvais dommage qu’elle soit perdue, d’autant que je pense que mon père ne refera plus d’album.
Il prend sa retraite ?
Il a 81 ans. Je ne suis pas certain qu’il ait encore la niaque pour écrire un autre disque. Il a le sentiment d’avoir déjà traité pas mal de sujets dans ses chansons, et parfois deux ou trois fois. Alors faire un album pour faire un album, quel intérêt quand on a déjà une telle carrière ? Même s’il reste alerte sur l’actualité, je pense qu’il se sent moins dans le coup pour écrire sur la société.
Vous le faites à sa place avec la chanson « Parlez-moi de demain » qui clôt l’album ?
Comme tout le monde, j’ai été choqué par l’attaque du 7 octobre et toutes ces vieilles idées que ce conflit a réveillées. Je ne voulais pas être dans les poncifs, mais j’ai un enfant et ça m’inquiète, ce retour de l’antisémitisme dans nos sociétés. En prenant ma guitare, j’ai eu envie d’inventer un personnage vers qui me tourner plutôt que de dire des banalités. Suzy est une espèce de sage ayant suffisamment surmonté d’épreuves pour nous donner des réponses. J’ai réalisé que ce prénom faisait écho à celui de ma nièce Suzanne, qui est la petite dernière de la famille.
Dans « Pipo », vous nommez plus les choses…
Oh, je n’y révèle rien de neuf ! Elle a été longue à venir, mais je voulais m’amuser à écrire une chanson qui dresserait l’inventaire de tous les mensonges qui nous sont connus, du greenwashing à Harvey Weinstein. La phrase de Chirac parlant de se baigner dans la Seine avait été un point de départ, puis les JO sont arrivés et Anne Hidalgo a réalisé le rêve de son prédécesseur !
Est-ce que chanter c’est « lancer des balles », pour reprendre une expression souchonesque ?
Les chansons réunissent. Je l’évoque dans « Le Carnaval de Dunkerque ». Mes parents avaient des amis qui habitaient dans le Nord. Quand j’étais gamin, ils nous y emmenaient. Ces festivités se tiennent au mois de février, le pire de l’année : il fait froid et pourtant, voir tous ces gens soudain heureux, ça met un coup de pied dans la grisaille. C’est comme un tableau où toutes les couleurs se mélangent : l’instituteur parle avec le maire ou le médecin de la ville. L’histoire nous a montré que, dans les moments difficiles, l’être humain a besoin de musique, que ce soit la Movida après la période du franquisme ou bien la musique dans les champs de coton. On a besoin de chanter pour se rassurer.
« Le Sleep d’une vie sublime » ★★, Ours (Universal).
Source : Lire Plus