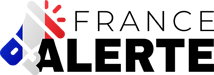Le JDD. Éric Anceau, vous proposez une nouvelle Histoire de la nation française quand vous, Guillaume Perrault, donnez à apprécier l’histoire de France au travers de grands récits réunis dans Voyages dans l’histoire de France. Souhaitez-vous, l’un et l’autre, réhabiliter le roman national ?
Éric Anceau. J’ai écrit ce livre parce que le sujet est au cœur de mes recherches, mais aussi, il faut le dire, en raison d’un certain agacement. Nous vivons une période d’affrontement, sur la scène publique, entre les tenants du roman national, né au début de la IIIe République et qui a perduré pendant un siècle, et ceux que j’appellerais les déconstructeurs. Cette déconstruction de ce qui fonde notre nation, promue par un certain nombre d’intellectuels et de politiques, est précisément à l’œuvre depuis un demi-siècle. Or, la vérité n’est ni dans le roman nation ni dans la déconstruction, elle se situe quelque part entre les deux, et le pendule de l’histoire doit être recentré. L’histoire n’a rien à faire avec l’idéologie.
Guillaume Perrault. On prête la paternité de l’expression « roman national » à l’historien Pierre Nora. Il désignait par là l’enseignement de l’histoire à l’école primaire au début de la IIIe République, à travers le manuel canonique d’Ernest Lavisse, qui était le grand maître de l’enseignement de l’histoire. Après le traumatisme de la guerre de 1870, de la défaite, de la perte de l’Alsace-Moselle, et au lendemain de la Commune de Paris, il fallait rendre leur fierté aux Français, les réconcilier, et garantir ainsi l’union nationale. Dans la France de Jules Ferry et à la génération suivante, l’enseignement de l’histoire et de la géographie revendiquait ce dessein patriotique et civique. Aujourd’hui, ce même enseignement est accusé, après coup, d’avoir subordonné la rigueur scientifique à un objectif politique. L’idée d’une continuité historique qui irait des Gaulois jusqu’à nous est débattue. Mais cette approche de l’histoire a constitué, en son temps, un des ciments de la nation.
Le passé est jugé à l’aune du présent
Guillaume Perrault
Faut-il lui préférer le récit national ?
G. P. Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, l’histoire ambitionne d’être une science. Mais une fois un savoir établi, encore faut-il l’enseigner à l’école. Des choix pédagogiques sont inévitables. Ce qu’on appelle « récit national » s’efforce de donner une cohérence à la présentation, à l’ordonnancement des faits autour d’une ligne directrice qui est la vie de la nation. Il valorise l’idée d’un lien puissant entre le passé et le présent. Mais le récit national a aussi le souci d’être irréprochable, autant que possible, sur le plan de la rigueur et du savoir transmis. C’est ce que je défends.
La suite après cette publicité
É. A. À la différence du roman national, le récit national n’occulte ni les pages glorieuses de notre histoire (et nous en avons beaucoup !) ni les pages plus sombres. Nous sommes une grande nation, devenue aujourd’hui très composite. Pour emmener tout le monde, il faut proposer un grand récit objectif. Pierre Nora ou Dominique Borne, ancien doyen de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, n’ont pas dit autre chose avant moi. Avec mon livre, je souhaite donner aux lecteurs tous les éléments fondamentaux pour qu’ils se fassent eux-mêmes leur idée.
Vous vous intéressez tous les deux à l’enseignement de la matière historique. A-t-on cessé, depuis les années 1970, d’inculquer l’histoire nationale ?
G. P. Je suis né en 1972 et j’ai été préservé des modes grâce à mes institutrices en fin de carrière, qui sont restées fidèles aux méthodes du Malet et Isaac en vigueur dans leur jeunesse. J’ai eu en main, dans ma modeste école primaire du 11e arrondissement de Paris, des manuels scolaires qui avaient certainement vingt ans d’âge et avaient survécu à toutes les réformes des années Giscard. J’ai été très marqué, comme je le raconte dans la préface de mon livre, par une lithographie représentant un épisode du XVIIIe siècle. On y voyait un général sur son lit de mort. Une bataille se poursuivait à l’arrière-plan. Le général demandait au médecin qui le soignait : « Combien de temps me reste-t-il à vivre ? » Réponse du médecin : « Pas une journée. » Réplique du général : « Tant mieux, je ne verrai pas les Anglais à Québec. » La légende expliquait que ce général s’appelait Montcalm et que la Nouvelle-France avait été perdue en 1759 par les Français et conquise par les Anglais pendant la désastreuse guerre de Sept Ans. J’avais 10 ans, c’était en 1982. Cette image m’a marqué pour le reste de mon existence. Cet enseignement traditionnel nous donnait l’impression d’être copropriétaire de ce passé. Il permettait d’entrer dans la vie avec un sentiment de sécurité.
Qu’est-ce qui a changé à la génération suivante ? La chronologie a été sacrifiée. Un bon élève peut entrer en première sans savoir si le Second Empire a précédé ou suivi la IIIe République. Il est donc très difficile aux jeunes de se repérer dans le temps de façon précise, ce qui est une condition pour agréger des connaissances. En outre, l’anachronisme règne : nous jugeons le passé à l’aune des valeurs du présent. Demandez à des bacheliers actuels de vous citer un personnage central de la Révolution française. Ils vous répondront, pour beaucoup, Olympe de Gouges. Les lycéens d’aujourd’hui en entendent plus parler en classe que de Sieyès, l’auteur de Qu’est-ce que le Tiers État ?, de Mirabeau, le grand orateur de l’Assemblée constituante, ou même de Robespierre, qui dominait les députés Montagnards, le Comité de salut public et le club des Jacobins. Ce n’est pas raisonnable.
Les élites ont largement dénigré la nation
Eric Anceau
É. A. Je suis un peu plus âgé que Guillaume et j’ai évidemment partagé la même expérience que lui sur les bancs de l’école. Une catastrophe est survenue dans la deuxième moitié des années 1970 avec l’introduction des activités d’éveil dans les écoles, au détriment des enseignements réputés plus traditionnels comme l’histoire. Dans le secondaire, le problème est arrivé un peu plus tard, lorsque Fernand Braudel, qui avait déjà invité ses collègues à se détacher du « fétichisme de l’événement », a pris la direction des programmes et a obtenu la réduction sensible de la part de la chronologie et des événements au profit d’une histoire qui prend de la hauteur (les civilisations) et qui se fait plus terre à terre (la vie quotidienne). Très vite, des politiques, à commencer par le président Mitterrand, se sont rendu compte que les enfants ne connaissaient plus le b.a.-ba, et on en est revenus. Aujourd’hui, l’antienne qui consiste à dénoncer les programmes demeure, mais la chronologie et l’histoire de France s’y trouvent bel et bien ; Jean-Michel Blanquer, quand il était ministre de l’Éducation nationale, et la commission des programmes en ont même rehaussé la place.
Cela dit, je partage le constat de Guillaume sur la bien-pensance et j’ajoute même deux éléments : la réduction des exigences scolaires et des horaires consacrés à l’histoire ! Là réside une grande partie du problème. Selon moi, il faut faire la part des choses entre le primaire, le secondaire et le supérieur. En primaire, il faut s’en tenir au récit, pour créer les conditions de la cohésion nationale. Le secondaire doit permettre à nos jeunes de s’ouvrir, une fois qu’ils ont acquis les bases, au monde, à d’autres approches, à la nuance. Enfin, le supérieur doit être le lieu par excellence où l’on fait découvrir à nos étudiants et futurs enseignants les avancées de la science historique, tout en s’assurant qu’ils maîtrisent eux-mêmes les fondamentaux.
Vous défendez tous les deux le récit national dans le but de faire nation. Pourquoi cette notion est-elle l’objet de tant de crispation ?
G. P. Ce qui suscite la furie dans la notion de récit national, ce n’est pas « récit » mais « national ». L’idée même de nation est au banc des accusés. L’air du temps favorise le ressentiment, un ton de justicier, une approche vindicative du passé. Il est difficile à l’enseignement de l’histoire de rester imperméable à ces tendances qui affectent la société et s’expriment puissamment dans l’espace médiatique. Aujourd’hui, pour beaucoup, rien ne doit être porté au crédit de la France, tout doit être porté à son débit. C’est un dogme, jamais formulé comme tel mais omniprésent, et contre lequel il faut lutter.
É. A. Sans verser dans la démagogie, car ce constat, même s’il appelle quelques nuances, je le partage largement, les élites ont une très lourde part de responsabilité dans le dénigrement de la nation, ce qui explique, pour partie, le fossé qui s’est creusé entre eux et les Français. Avec ce nouveau livre, mon objectif est également de redonner aux uns et autres des clefs pour refaire nation.


Source : Lire Plus