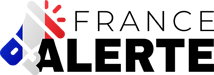Le JDD. Bayer est un groupe pharmaceutique et agrochimique. N’est-ce pas contradictoire ?
Yves Picquet. Nous sommes un des seuls groupes engagés à la fois en santé et dans l’alimentation à travers l’agriculture, deux besoins fondamentaux. D’où notre mission, « la faim pour personne et la santé pour tous ». Notre chiffre d’affaires – 46,6 milliards d’euros en 2024 dans le monde – est équilibré entre l’agro et la pharma. Nous transposons le savoir-faire de la recherche pharmaceutique dans la recherche agronomique : notre ADN, c’est l’innovation fondée sur la science.
Faut-il désormais être un scientifique pour être agriculteur ?
L’agriculture est en effet à mille lieues des images d’Épinal que l’on peut parfois en avoir ! Bayer est un acteur de cette transformation qui s’accélère. Grâce au breeding, par exemple [les nouvelles techniques de sélection des plantes, NDLR], qui permet d’avoir des semences plus résistantes, qui nécessitent en conséquence moins de produits phytosanitaires. Avant, on protégeait les cultures sans se soucier du détail, ce qui a complètement changé grâce aux satellites, aux outils d’aide à la décision, qui nous donnent les seuils d’évolution de populations d’insectes ravageurs, des différentes maladies… On sait alors si l’on doit traiter au bon endroit, avec la bonne dose et au bon moment. C’est l’économie de la fonctionnalité : de plus en plus, nous allons vendre des hectares de cultures exemptes de maladies plutôt que des bidons de produit. Nous travaillons déjà en France sur ce modèle avec près de 250 agriculteurs, sur 10 000 hectares, et notre objectif est d’arriver à 100 000 hectares à l’horizon 2030.
La demande du monde agricole évolue-t-elle ?
La suite après cette publicité
Un mouvement est lancé depuis une vingtaine d’années : on ne traite plus à l’aveugle ! Après-guerre, on s’est focalisé sur les rendements et on ne s’est pas assez soucié des sols, ni de la rotation des cultures, pourtant essentielle, qu’on envisage aujourd’hui sur plusieurs années, pour améliorer la santé des sols.
« Notre grand défi, c’est de déployer nos outils à la ferme. C’est là que les instituts, les écoles, les coopératives doivent jouer le jeu »
Quelle est l’évolution du côté de la recherche ?
Chez Bayer, mille chercheurs dans le monde travaillent sur nos nouvelles solutions, dont 400 en France, avec des outils dont 80 % n’existaient pas il y a encore cinq ans : l’intelligence artificielle, les jumeaux numériques… C’est une révolution ! Pour la division Crop Science, Bayer investit chaque année plus de 2 milliards d’euros dans la R & D [recherche et développement].
Cela suffit-il à vous défaire d’une image de grand pollueur ?
Ce maillon de la protection des cultures est essentiel. Certains croient que l’on peut s’en passer. Mais si l’on veut produire suffisamment, il faut réussir une triple performance : l’agriculteur doit subvenir à ses besoins, on doit remplir les assiettes à un prix abordable et il faut que cela respecte la planète. Chaque jour, nous avançons dans cette direction. Ce n’est pas facile : une opposition solide s’est créée et cherche à discréditer ces innovations et celles et ceux qui les utilisent. Nous leur disons : venez voir dans les laboratoires, venez dans les champs ! Par exemple, sur les pulvérisateurs, nous avons désormais des caméras qui reconnaissent les mauvaises herbes et vont agir de manière ciblée uniquement sur celles-ci.
Tous les agriculteurs n’en sont pas là ! L’enseignement et la formation suivent-ils ?
Notre grand défi, c’est de déployer nos outils à la ferme. C’est là que les instituts, les écoles, les coopératives doivent jouer le jeu. Les images d’Épinal arrangent sans doute certains, mais les agriculteurs sont aujourd’hui très concernés et très connectés. Nous travaillons avec d’excellents établissements, comme UniLaSalle Beauvais et sa chaire de robotique. Nous avons aussi des projets communs avec la recherche publique, un laboratoire mixte dans notre centre de R & D à Lyon et nous accueillons des start-up que l’on accompagne dans le développement de leurs produits.
Aux États-Unis, vous affrontez les procès sur le glyphosate. Dans quel état d’esprit ?
Scientifiquement, toutes les agences réglementaires et leurs évaluations scientifiques dans le monde disent la même chose : dans des conditions normales d’utilisation, ce produit n’est pas dangereux – à l’exception du CIRC qui le juge « probablement » dangereux. Aux États-Unis, sur les 25 derniers jugements, nous en avons gagné 17. Les décisions s’opposent d’un État à l’autre ; la prochaine étape sera la Cour suprême.
« On sait à présent traiter de manière ciblée avec la bonne dose »
Ces procès sont coûteux et Bayer est lourdement endetté. Le rachat de Monsanto était-il une erreur ?
Le cours de l’action a fortement baissé, je ne vais pas vous dire que tout va bien. Mais quoiqu’en pensent certains, c’était stratégiquement une bonne décision car nous nous sommes développés dans les semences, dans le numérique et sur le continent américain grâce à Monsanto.
En France, un procès s’est tenu à Vienne le mois dernier : la famille de Théo Grataloup impute ses graves malformations au glyphosate. Le jugement est attendu le 31 juillet et vos détracteurs espèrent une condamnation historique…
Ce garçon et sa famille vivent une épreuve terrible, nous leur adressons nos pensées respectueuses. Nous avons donné les informations demandées et attendons désormais la décision du tribunal qui pourra se fonder sur des éléments factuels et scientifiques : nous avons confiance en la justice française.
Bill Anderson, PDG monde de Bayer, a suggéré devant vos actionnaires fin avril que la multiplication des procès pourrait conduire le groupe à cesser de vendre du Roundup…
Concernant le glyphosate, le dossier scientifique est solide. Néanmoins, certains continuent d’en contester la sécurité – en allant parfois jusqu’à utiliser des informations trompeuses. Malheureusement, nous atteignons un point où cela pourrait nous contraindre à arrêter la vente de ce produit. Nous ne pouvons en effet pas continuer à vendre un produit approuvé tout en perdant des milliards de dollars dans le processus.
En France, vous avez supprimé 400 postes. Peut-on y être compétitif ?
Cent cinquante de ces postes étaient vacants et on en a recréé d’autres. Au total, au terme du processus, on devrait arriver à 150 suppressions nettes. En France, nous avons d’abord une histoire, avec l’ancrage lyonnais issu du rachat de Rhône-Poulenc. Il y a aussi une compétence très forte. Je vous jette des fleurs d’autant plus librement que je suis Belge : il existe bien un génie français ! Malgré le niveau de taxation et le coût de l’énergie, être compétitif reste possible, grâce à des mécanismes comme le crédit d’impôt recherche (CIR). Nous investissons entre 120 et 150 millions d’euros en R & D chaque année en France. Ce pays, à certains égards, est ce que l’on fait de mieux en Europe : la variété des terroirs, la technicité et la production de semences, une filière d’excellence !
Source : Lire Plus