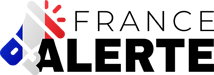Couturière discrète, la mère de Marcel Pagnol, Augustine, incarne l’amour absolu, l’absolue douceur. Dans ses Souvenirs d’enfance, le conteur de la Provence la dépeint comme une présence silencieuse et rayonnante. Cette mémoire, idéalisée, sacrée, hante toute son œuvre, même cinématographique. Dans le film Naïs, Toine, un valet de ferme bossu, évoque la bonté parentale avec émotion : « Chez les paysans, il n’y a pas d’armoire à glace. On ne se voit que dans les yeux de sa mère, naturellement on s’y voit beau. »
Cette idéalisation vient en partie de ce que sa mère meurt alors que Marcel n’a que 15 ans. Il en ressentira toute sa vie une douleur irréparable. Chez lui, la mère est une lumière enfuie que la mémoire échoue à faire luire à nouveau : « Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d’inoubliables chagrins. Il n’est pas nécessaire de le dire aux enfants », écrit-il dans… Le Château de ma mère. Mais, quelques mois à peine après le décès d’Augustine, le jeune Marcel écrivait déjà le poème Rêverie : « Je crois voir brusquement de la terre / Surgir le noir Pluton qui promène Cerbère / Il vient se délasser, fatigué de régner. » Dans ses songes d’enfant, ce qui était sombre finissait par être lumineux : le jour se levait sur le Garlaban. Georges Grange
Louis Aragon : « Tu m’as donné ta vie en me donnant la vie »
C’est peu de dire que Louis Aragon vécut une relation douloureuse avec sa mère. Né d’une liaison hors mariage, il fut élevé dans un mensonge fondateur : sa mère fut présentée comme sa sœur, sa grand-mère comme sa mère et son père comme… son parrain. Sa mère ne lui révèle ce secret que lors de sa mobilisation sur le front en 1917. Homme de lettres, c’est la plume qui panse ses blessures : comment ne pas comprendre l’homonymie du mot « mère » dans son poème L’Escale : « La mer comme le sable est sujette aux mirages / Et celle qui criait la langue des naufrages / N’est que l’illusion qui me reprend souvent » ? Certains ont même vu dans la figure d’Elsa Triolet, son grand amour, la projection de la mère retrouvée.
Le poème Le Mot est peut-être la plus déchirante évocation de ce fardeau. À la mort de sa mère en 1942, Aragon n’ose pas dire « maman », le mot qui « n’a pas franchi [ses] lèvres », mais ses huit strophes sonnent comme un adieu bouleversant : « Ceux peut-être qui me comprennent / Ne feront pas les triomphants / Car une morte est une reine / À son enfant. » Puis il imagine l’histoire d’amour de sa mère et de son père et en conclut : « Tu m’as donné ta vie en me donnant la vie. » L’amour d’un fils était plus fort que le mensonge. G. G.
Romain Gary : « On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné »
« Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais. Chaque fois qu’une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. » Peut-on se remettre de cette blessure originelle ?
La suite après cette publicité
Dans La Promesse de l’aube, récit autobiographique d’où sont tirées ces lignes, Romain Gary raconte la relation qui le lie à sa mère, Mina Owczyńska. Après avoir quitté la Lituanie avec son fils sous le bras, Mina élève seule son fils dans le sud de la France, à Nice. Gary dépeint une femme ambitieuse, animée par le dessein qu’elle envisage pour son fils. Caricature de la mère juive, leur lien est tout à la fois une bénédiction et un fardeau. Si Gary en fait, dans ses confidences au journaliste Patrice Galbeau, une « emmerdeuse », qui l’a maintes fois embarrassé, il ne sait parler d’elle sans admiration. Mina meurt en 1943, loin de son fils, parti combattre dans les Forces aériennes françaises libres. Ayant anticipé sa propre disparition, elle lui adresse des lettres posthumes, preuve de son amour inconditionnel, par-delà la mort. Aziliz Le Corre
Colette : « Ma charmante toquée de mère »
Il est des mères qui ne meurent jamais – elles renaissent dans les livres, s’invitent dans chaque ligne et deviennent personnage plus que souvenir. Sido, la mère de Colette, est de celles-là : réinventée, sublimée, fantasmée par la matière littéraire de sa fille. Adèle Eugénie Sidonie Landoy, dite Sido, gouvernait sa maison comme un petit royaume – avec une autorité tendre et fantasque. Anticonformiste, panthéiste instinctive, elle communiait avec les bêtes, dictait ses lois, fascinait autant qu’elle étouffait. Dans La Maison de Claudine (1922), La Naissance du jour (1928) ou Sido (1930), Colette brosse le portrait d’une femme bohème et rustique, une philosophe domestique capable d’extraire de la moindre anecdote une lueur de vérité. Mais cette célébration trahit un lien plus trouble.
« Ma charmante toquée de mère », disait Colette, lucide sur la domination douce mais implacable que Sido exerçait. Étouffante, libre, fascinante – Colette lui doit aussi ses désirs de fuite et d’émancipation. Reste que Sido lui a légué l’essentiel : le goût du monde sensible, l’attention au tremblement d’une feuille, à l’odeur d’une peau. L’écriture charnelle de Colette est née de ce terreau. Et peut-être que toute son œuvre est un dialogue ininterrompu avec cette mère source et mirage, celle qui, par sa singularité radicale, lui a transmis le plus précieux : regarder et ne jamais cesser d’émerveiller. Alix Avril
Marcel Proust : « Elle avait penché vers mon lit sa figure aimante »
La véritable mère de Marcel Proust demeura longtemps éclipsée par son double fictif, cet être dont l’attente jette chaque soir le narrateur d’À la recherche du temps perdu dans les affres de l’angoisse : « Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m’embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite, que le moment où je l’entendais monter […] était pour moi un moment douloureux. » Jeanne Proust joua pourtant un rôle décisif dans la formation du futur écrivain, qui tenait d’elle son goût pour la littérature – la publication de leur correspondance témoigne du côté maternel d’un véritable talent de plume. Elle n’eut de cesse d’appeler Marcel à faire preuve de caractère. Avec davantage de succès que sa jumelle de papier dans La Recherche, laquelle finit par céder aux caprices de l’enfant et prendre place dans le lit pour lui lire François le Champi de George Sand. C’est aussi à partir de sa traduction que Proust donnera une version française de La Bible d’Amiens de John Ruskin.
Proust n’entreprit d’écrire son chef-d’œuvre qu’après le décès de sa mère, survenu en 1905. Les premières pages, aux limites de l’hallucination, ramènent la disparue d’outre-tombe : « […] elle avait penché vers mon lit sa figure aimante, et me l’avait tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m’endormir ». Quelques centaines de pages plus loin, mère et fils forment un couple fusionnel le temps d’un voyage à Venise, passage parmi les plus émouvants du roman. En ce 120e anniversaire de la disparition de Jeanne Proust, pourquoi ne pas offrir à votre mère À la recherche du temps perdu ? Éric Naulleau
Antoine de Saint-Exupéry : « Maman, embrassez-moi comme je vous embrasse du fond de mon cœur »
« Dites-vous, ma petite maman, que vous avez peuplé ma vie de douceur comme personne n’aurait pu le faire. » La rose du Petit prince, c’est entendu, s’appelle Consuelo, la femme d’Antoine de Saint-Exupéry. N’est-ce pas aussi un peu sa mère Marie ? Elle est sa confidente, la première destinataire de ses élans d’affection : « Vous êtes ce qu’il y a de meilleur dans ma vie ». Son plus grand amour ? Elle est en tout cas un repère, dans les turbulences de son métier d’aviateur et les orages de sa vie. Éternel « exilé de son enfance », le grand Saint-Ex reste le petit Tonio pour qui sa mère s’inquiète.
L’enfant inconsolé se fait à son tour consolateur de celle qui a déjà perdu deux enfants et son mari. Elle lui a transmis sa sensibilité, son goût du silence et peut-être sa soif immense. Il l’appelle son « réservoir de paix », sa « bonne étoile ». Il ne cessera de lui écrire… « Maman, embrassez-moi comme je vous embrasse du fond de mon cœur », conclut sa dernière missive, qu’elle recevra un an après sa disparition. Il lui doit tant d’amour, tant de tourments. Qu’as-tu, que tu n’aies reçu ? Humbert Angleys
Guillaume Apollinaire : Une mère qui ne « l’habille que de bleu et de blanc »
Né de géniteur inconnu, Guillaume Apollinaire passa une enfance chahutée en compagnie de sa mère. De Monaco à Lyon en passant par la Belgique où celle-ci laissa le futur poète et son frère cadet Albert dans une auberge d’où ils furent contraints de déguerpir nuitamment à la cloche de bois.
Peu d’œuvres portent cependant avec tant d’évidence l’empreinte maternelle. Très pieuse, Angelica n’en vivait pas moins d’expédients peu avouables, mélange des genres qui marque Alcools, le plus célèbre recueil de son fils, paru en 1913. Où l’on trouve pêle-mêle une évocation des hôtels borgnes et une célébration du pape : « Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes / La religion seule est restée toute neuve la religion / Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation / Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme / L’Européen le plus moderne c’est vous pape Pie X. » Angelica avait voué Guillaume à la Vierge (« Ta mère ne t’habille que de bleu et de blanc » est-il écrit dans Zone), il suivait sa scolarité dans des établissements religieux, toutes données immédiates de son existence qui expliquent certains vers stupéfiants. Stupéfiants et même plus subversifs de nos jours qu’à l’époque où ils furent publiés – tant se réclamer aujourd’hui du christianisme paraît aux yeux de certains plus scandaleux que de s’être réclamé hier du stalinisme ou du maoïsme : « C’est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche / C’est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs / Il détient le record du monde pour la hauteur ». D’une tradition catholique héritée de sa mère, Apollinaire fit le tremplin de la plus fulgurante modernité. É. N.
Alphonse de Lamartine : « Ma mère était une sainte »
« L’âme de la mère de Lamartine plane sur toute son œuvre », souligne Pierre de Lacretelle dans l’ouvrage consacré à la trajectoire du poète, Les Origines et la jeunesse de Lamartine.
Issue d’une famille noble mais modeste, Alix des Roys est une femme pieuse et cultivée. Elle se dévoue à ses huit enfants et éveille chez son fils aîné, Alphonse de Lamartine, son amour pour la littérature, teinté d’une sensibilité romantique – elle admire particulièrement Rousseau. Les Méditations poétiques (1820) feront d’ailleurs écho aux Confessions de Jean-Jacques. Lamartine y réveille les souvenirs de son enfance passée à Milly. Sa quête d’un idéal perdu porte déjà l’empreinte de la présence maternelle.
Dans les recueils qui suivront, l’hommage devient plus appuyé mais se confond toujours avec l’amour du poète pour sa terre natale. Dans La Vigne et la maison (Nouvelles Méditations poétiques, 1823), Lamartine s’adresse directement à Alix : « Ô ma mère, ta voix dans ces lieux retentit / Ton ombre sur ces murs doucement se dessine / Ton souffle harmonieux dans ces vignes s’unit / Au murmure des eaux, au chant de la colline. »
La mort de sa mère, en 1829, est un choc pour le poète. Dans ses Confidences (1849), Lamartine évoque sa mémoire : « Ma mère était une sainte, une âme pure et élevée, dont la piété simple et la charité sans bornes ont formé mon cœur à la vertu et à la poésie. Elle m’apprenait à voir Dieu dans la nature et à aimer les hommes dans leurs misères. » À croire que l’amour maternel est ce qu’il y a de plus divin sur terre. A. L. C.
Georges Bernanos : « Notre mère, la nouvelle Ève »
« Nous avons été élevés par de trop bonnes mères, trop patientes, trop courageuses, si dures à la besogne, si dures et si douces, avec leurs tendres cœurs vaillants, inflexibles », cingle le Bernanos pamphlétaire (Nous autres Français). Comment imaginer qu’il n’évoque pas sa mère berrichonne, Marie-Clémence, dite Hermance, à qui il doit sa foi fervente ? Leur correspondance témoigne d’une relation aimante, bien qu’un peu distante.
Dans son œuvre ardente, les figures maternelles apparaissent secondaires : dans Journal d’un curé de campagne, la mère du curé d’Ambricourt incarne la pauvreté et le sacrifice ; celle de Mouchette est effacée dans Sous le soleil de Satan… Chez Bernanos, la mère est moins sentimentale que spirituelle. C’est la prieure des Dialogues des carmélites, inflexible mais maternelle, c’est enfin et surtout la Vierge Marie, la mère absolue : « notre mère, c’est entendu. Elle est la mère du genre humain, la nouvelle Ève », souffle le vieux curé de Torcy. « Une mère voit tout » (La Joie) : pour Bernanos, chantre de l’esprit d’enfance, la mère transmet l’exigence du combat spirituel, qui défait les tourments par l’espérance. Humbert Angleys
Victor Hugo : « Mon cœur me dit que c’est ta fête »
Avant d’être un monument national, Victor Hugo fut un fils aimé, façonné par la tutelle douce et ferme d’une femme hors du commun. Sa mère, Sophie Trébuchet, femme de lettres et de caractère, l’éleva presque seule dans un ancien couvent parisien devenu royaume d’enfance : les Feuillantines. Royaliste dans un monde d’Empire, éprise d’indépendance et de poésie, elle fut pour Victor une autorité tendre, un refuge dans les désordres conjugaux, une boussole dans la tourmente politique.
C’est elle qui, la première, devine le génie de son fils, l’écoute, le soir, réciter ses vers. Lorsqu’elle meurt brutalement en 1821, Hugo a 19 ans. Il dessine ce jour-là une tête de mort dans son carnet : symbole muet d’un deuil fondateur. Mais ce que le dessin ne peut exprimer, la poésie le dira. Il lui dédie ses premiers recueils, la voit en rêve jusque dans l’exil et fait d’elle la source secrète de toute une œuvre. Car partout dans Les Misérables, Les Feuilles d’automne, se tisse en filigrane le portrait d’une maternité idéalisée – faite de force, d’abnégation et d’amour absolu – qui doit presque tout à Sophie Trébuchet. En 1874, plus de cinquante ans après sa disparition, Hugo publie Quatrevingt-treize, roman peuplé d’héroïnes obscures et sublimes : on y devine, à demi-mot, l’ombre de sa mère. « Mon cœur me dit que c’est ta fête / Je crois toujours mon cœur quand il parle de toi / Maman, que faut-il donc que ce cœur te souhaite ? / Des trésors ? Des honneurs ? Des trônes ? Non, ma foi ! / Mais un bonheur égal au mien quand je te vois. » (Victor Hugo, poème écrit le 27 septembre 1816, à 15 ans. A. A.
Source : Lire Plus