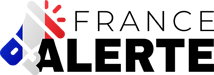Il est comme un poisson dans l’humour où il baigne depuis ses débuts avec Les Inconnus. Elle est plus familière des drames au cinéma, où elle a construit sa carrière marquée par Nikita. Leur collaboration ne pouvait pas manquer de piquant. Dans Le Bémol, mis en scène par Anne Bouvier, et aux côtés de Lionel Abelanski, Pascal Légitimus et Anne Parillaud se retrouvent mari et femme. Une pièce pleine de drôlerie où un chef d’orchestre bascule en pleine crise existentielle, bouleversé par un malencontreux si bémol joué par son violoniste et meilleur ami. Entre ces deux acteurs aux univers si différents, les violons sont pourtant parfaitement accordés.
Le JDD. Vous vous connaissiez ?
Pascal Légitimus : Nous avons partagé l’affiche d’un film en 2007, Demandez la permission aux enfants ! d’Éric Civanyan, mais nous avions eu très peu de scènes ensemble. Il nous est arrivé parfois de nous croiser et nous avons dîné ensemble.
Anne Parillaud : Là, il y a quelque chose de beaucoup plus excitant et aventureux pour moi à partager…
P. L. : J’entends que je suis un acteur excitant. C’est gentil, merci !
La suite après cette publicité
A. P. : C’est une vraie aventure pour moi, loin de ma zone de confort, celle de la tragédie, en tout cas de choses plus graves et engagées.
Avez-vous posé un bémol, justement, avant d’accepter le rôle ?
P. L. : Aucun. Il n’y a pas eu d’hésitation de ma part, j’ai très vite vu ce que je pouvais en tirer. Je me décide toujours assez rapidement. On m’a donné le texte un soir à 20 heures. À 22 heures, c’était plié : j’acceptais sans même savoir qui seraient mes partenaires.
A. P. : Cela s’est passé différemment pour moi. Anne Bouvier, qui m’avait déjà mise en scène dans Je ne serais pas arrivée là si… m’a parlé de la pièce qu’elle allait monter. « Ça ne te plaira sans doute pas, a-t-elle ajouté. Je sais que tu n’aimes pas la comédie mais ne me demande pas pourquoi, j’ai envie que tu la lises quand même. » Comme je suis curieuse, j’ai accepté. Et, à ma grande surprise, j’ai été aussi séduite que très perturbée. Perturbée d’être attirée par quelque chose de si éloigné de moi, au point de me demander si j’étais toujours capable de discerner ce qui me convenait. Je l’ai passée à mon agente qui, à son tour, m’a encouragée à me lancer.
P. L. : Tu oublies de dire que tu m’as aussi appelé pour me demander mon avis ! Et je t’ai répondu, d’une manière assez prétentieuse, que lorsque je choisis un projet, en général, je ne me trompe pas. En ce qui concerne la comédie, je sais quand il y a matière à jouer et à jouir. Comme dans Le Prénom, il y a dans Le Bémol un déclencheur, et après, tout part en cacahuète.
Je trouve le petit truc en plus qui fait rire
Pascal Légitimus
A. P. : Nous sommes loin du boulevard avec l’amant dans le placard et les portes qui claquent. La pièce est une vraie comédie de mœurs où chacun des personnages a une belle partition à jouer. À partir de là, j’ai foncé, mais me lancer là-dedans reste un vrai défi pour moi. J’en fais même des cauchemars !
Pourquoi êtes-vous aussi inquiète ?
A. P. : J’ai grandi dans d’autres chapelles plus cérébrales, comme celle de Francis Girod ou de Catherine Breillat. Une part de moi avait intégré le fait que je n’étais pas destinée à la comédie. Pourtant, les gens qui me connaissent bien, ceux avec qui je suis vraiment à l’aise, me disaient que je devais en faire. J’ai été la première surprise l’année dernière de découvrir que je pouvais faire rire avec la pièce d’Annick Cojean, Je ne serais pas arrivée là si…
Je l’ai jouée sans chercher à être drôle et pourtant la salle était pliée en deux. D’un seul coup, j’ai ressenti une sensation physique que je ne n’avais jamais connue. Mon ambition n’a jamais été d’être heureuse mais de réussir mes engagements. Cette fois, pour la première fois de ma vie, je découvre le plaisir et la liberté de jouer.
P. L. : Il y a deux aspects dans la comédie : la situation qui est drôle parce qu’elle a été écrite comme cela, et la créativité. Très peu d’acteurs sont capables d’inventer quelque chose de drôle à partir de ce qui ne l’est pas. Avec l’expérience, vous pouvez me donner n’importe quoi et je trouverai le petit truc en plus qui fera rire. Mais, comme je le dis souvent : « On n’amuse pas avec du bonheur. »
Toute comédie est d’abord un drame. Prenez La Grande Vadrouille : vous retirez les Allemands, ce n’est plus drôle. Dans Les Trois frères, je perds mon boulot, Didier (Bourdon) se fait virer de chez ses beaux-parents, Bernard (Campan) est un raté, on récupère un gamin, on n’a pas d’argent, on a les flics aux trousses… C’est la théorie du bouchon de liège : plus on enfonce les héros, plus on se demande comment ils vont remonter ! Le danger de la comédie, c’est de tomber dans la facilité.
Lequel de vous deux est le plus amusant, le plus léger ?
A. P. : Je pense que c’est Pascal. Je dois peser quinze tonnes !
P. L. : Et moi, une tonne. C’est déjà pas mal !
A. P. : On le voit dans mon travail. Ce qui m’habite est très chargé. Je suis dans cette complexité de l’organique animal tout en étant totalement cérébrale. Ça passe du ventre à la tête, de la tête au ventre, dans les deux sens et sans arrêt. Je réfléchis beaucoup, je cherche, j’explore, je me questionne. C’est sans limite. J’ouvre une porte, puis une autre, et encore une autre…
P. L. : C’est quoi, le but ? Dans quel intérêt ?
A. P. : C’est là où nous sommes très différents. Je n’ai pas le choix, je suis fabriquée comme cela.
P. L. : Tu ne veux pas changer ? Moi, j’ai changé.
A. P. : Non, parce que c’est la matière première que j’ai envie de partager. Toutes ces sous-couches me nourrissent et j’adore ces profondeurs.
P. L. : J’ai la même matière que toi, mais cela ne sert à rien de tout prendre au sérieux. Les souffrances de mon enfance, je les ai transformées pour en faire quelque chose de drôle. Je trouve beaucoup plus intéressant de partager les événements dramatiques enrobés d’un petit cadeau amusant.
A. P. : Je ne me prends pas du tout au sérieux. J’aime juste naviguer dans les souterrains. Si je pouvais ouvrir en deux et disséquer tout ce qui se passe dans la tête des gens…
P. L. : Je fais la même chose. Je retranscris la vie. Avec Les Inconnus, on n’a construit que cela : arranger les choses dramatiques pour les tourner en dérision.
Qu’est-ce qui vous frappe le plus chez l’autre ?
A. P. : Peut-être ce dont on vient de parler. La légèreté, je ne connais pas, alors j’admire la fantaisie chez les autres.
Je suis fascinée par tout ce qui est déréglé
Anne Parillaud
P. L. : Anne est une grosse, grosse, bosseuse. Rien n’est superficiel chez elle. Ça l’obsède, au-delà du travail. Au lieu d’y passer deux heures, elle va y passer quatre ou six heures pour aller chercher la perfection.
A. P. : La pire phrase pour moi c’est : « C’est bon, ça va. » Je ne comprends même pas ce langage. Ça va, ça va quoi ? Non, c’est bien ou ça ne l’est pas.
Vous avez tous les deux débuté au théâtre. Quels souvenirs en gardez-vous ?
P. L. : Je me rappelle que j’enchaînais les projets, je courais d’une pièce à une autre. En 1981, j’avais décroché un rôle dans une pièce de la Comédie-Française jouée au théâtre de l’Odéon, Memphis. J’avais quatre phrases à dire et je jouais du banjo. Et après je filais jouer, tard le soir, dans T’as pas vu mes bananes ? un spectacle de café-théâtre avec mon camarade Seymour Brussel. Le lendemain, j’enchaînais avec du doublage de film. Puis, très vite, j’ai rejoint le Théâtre de Bouvard.
A. P. : J’ai débuté en étant la fille de Jeanne Moreau et de Jacques Dufilho dans L’Intoxe. Pendant neuf mois, j’ai joué avec eux au théâtre des Variétés. Avec Jeanne comme modèle, j’ai beaucoup appris. La pièce a continué mais sans moi, parce qu’Alain Delon est venu me chercher et il a fait casser mon contrat. Je l’ai suivi dans un premier film, Pour la peau d’un flic, puis un second, Le Battant, et tout s’est enchaîné après.
P. L. : Moi, j’ai privilégié la scène. Je suis un acteur de composition. Quand je suis moi-même, ça me gave un peu. C’est pour cela que j’essaie d’orienter tous les réalisateurs à me confier des rôles où je me transforme vraiment.
A. P. : J’ai dit à l’époque : « Le théâtre, plus jamais ! » Quand on n’a pas le rôle principal ou un personnage important, être coincé pendant neuf mois sans pouvoir faire autre chose, c’est trop long, surtout quand on a 20 ans. J’ai mis autant de temps à revenir sur scène, avec Le Lauréat en 2018. Jouer Mrs Robinson m’a totalement réconciliée avec les planches. Maintenant, j’adore cela. Ce qui ne m’empêche pas de me demander à chaque fois pourquoi je me fustige autant. Puis dès que les représentations commencent, si tout se passe bien, je me dis que ça n’a pas de prix.
Très vite, le succès est arrivé. Avec Les Inconnus pour vous, Pascal…
A. P. : J’étais totalement fan ! Pourtant, je ne suis pas une cliente facile. Beaucoup d’artistes ne me font absolument pas rire. J’aime l’absurde, quand on tourne en dérision la tragédie humaine. J’ai découvert que l’humour est plus intime que le drame. Quand on partage un fou rire avec quelqu’un, on se dévoile vraiment. Les pleurs, on peut décider de les garder, les cacher ou les arrêter. Il y a un contrôle sur les larmes qu’il n’y a pas dans le rire. On ne peut pas s’empêcher de se marrer.
P. L. : C’est vrai. Quand on rit, on ne pense pas, il y a un lâcher-prise total. Je suis heureux de voir que ce qu’on a créé avec Les Inconnus continue à perdurer. C’est gratifiant. On a apporté quelque chose, on a fait bouger les lignes. Encore aujourd’hui, des gens me disent que grâce à nous, ils ont compris plein de trucs.
Nikita a-t-elle aussi fait bouger les lignes ?
A. P. : Elle a été la toute première femme d’action, dans un rôle normalement destiné aux hommes. Même aux États-Unis, ça n’existait pas. Angelina Jolie et les autres sont arrivées après. Luc Besson a vraiment ouvert cette porte-là. Ce qui me plaisait avec Nikita, encore une fois, c’est qu’elle a un fond : à l’extérieur, c’est une femme d’action, mais à l’intérieur, elle est perforée, effrayée, cassée. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir dans sa carrière un film culte. J’en ai au moins eu un et j’en suis très fière. Je le prends comme un immense cadeau, mais un cadeau empoisonné.
Pourquoi empoisonné ?
A. P. : Parce qu’il a été difficile de trouver des rôles après. Dans Nikita, la palette de jeu était vraiment complète. Elle a tous les styles de coiffures, les couleurs de cheveux… Elle commence clocharde pour finir dans un glamour absolu. Et dans l’interprétation, on part d’une totale ébréchée, toxico, pour arriver à une serial killeuse dans la maîtrise et la classe la plus totale. La création étant une inspiration, quel metteur en scène peut se projeter ensuite et m’imaginer dans autre chose ? Avec ce rôle merveilleux, j’ai tout fait. Elle est devenue iconique et les gens ne veulent plus que vous la quittiez. C’est à moi de remettre des bûches pour montrer de quoi je suis capable d’autre.
Avez-vous des violons d’Ingres ?
P. L. : Depuis l’âge de 12 ans, je collectionne des coquillages. J’en ai 250. Pour m’amuser, j’ai commencé à les mettre en scène et à les photographier. Je suis le seul à faire cela. Au départ, c’était une passion, c’est presque devenu un business : j’ai créé une société qui s’appelle Artimus Photoraphy. Mes clichés commencent à avoir du succès : j’en ai vendu trois à Drouot il y a deux ans, ils sont cotés. Ils me permettent de voyager et de rencontrer des gens.
A. P. : Moi, je suis passionnée par l’humain. C’est vraiment mon obsession. Je suis fascinée par tout ce qui est déréglé, les criminels, les dérangés, les monstres… Je cherche à comprendre tout ce qui est hors cadre. Je voulais être pénaliste et ça ne m’a jamais quittée. Je ne plaide pas en robe dans un tribunal, mais je le fais au cinéma : chaque fois, je choisis des rôles où il faut vraiment défendre l’individu.
Source : Lire Plus