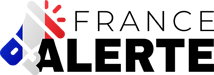On n’oublie pas ses premières amours. Lemmy Kilmister savait ce qu’il devait à Lucas Fox. C’est avec ce batteur lui aussi Britannique que le chanteur et bassiste de Motörhead a posé les bases de ce qui allait devenir l’un des groupes les plus cultes, non seulement du heavy metal, mais aussi de la pop culture. L’entente est immédiate entre ce fils d’aumônier de la Royal Air Force ayant déserté le foyer familial quand le futur rebelle avait trois mois, et le rejeton d’un pilote de guerre élevé dans un cadre familial équilibré. Installé depuis près de quarante ans dans notre capitale, Lucas Fox, le musicien ayant trouvé le nom et le lettrage du groupe Motörhead, a commencé il y a une dizaine d’années à regrouper ses souvenirs dans un passionnant récit sur une époque où les mots sexe, drogue et rock’n’roll n’étaient pas de vains mots. À 72 ans, il n’était pas trop tard pour ressortir le perfecto du placard.
Le JDD. Comment ce livre est-il né ?
Lucas Fox. En 2014, je suis allé voir Motörhead au Zénith. J’avoue que j’appréhendais ce moment. Nous ne nous étions pas vus, Lemmy et moi, depuis une bonne dizaine d’années. Il vivait à Los Angeles et moi à Paris. La veille du concert, j’ai commencé à consulter le site officiel du groupe, remontant le fil des dates depuis quarante ans. Le jour dit, alors que je patientais dans les coulisses, des flashs ont commencé à ressurgir. De retour chez moi, je me suis installé sous le vasistas de mon appartement et j’ai vu apparaître des hologrammes à travers la lumière verticale venant de l’extérieur : c’était comme des capsules mémoires prêtes à s’ouvrir.
Avez-vous été surpris de devenir ami avec Lemmy Kilmister ?
Oui, car sur le papier, nous étions à l’opposé l’un de l’autre. Neveu d’un espion britannique et fils d’une commandante de la WAAF [Women’s Auxiliary Air Force, une division féminine de la Royal Air Force, NDLR] sur la base de Tempsford, là où étaient formés les résistants envoyés dans toute l’Europe à partir de 1942, j’avais connu une jeunesse plutôt équilibrée au lycée français de Londres. Mais, à l’âge de 9 ans, la passion de la batterie m’a saisi de plein fouet. Tout de suite, on s’est bien entendus, Lemmy et moi, sur nos goûts musicaux. Je le pensais dans le progressive rock, c’était tout l’inverse : il ne jurait que par les groupes des années 1960, les Beatles, les Byrds ou les Pretty Things avec Ronnie Wood. Mais on partageait aussi une passion pour les MC5 !
La suite après cette publicité
Dans quel état d’esprit était-il quand vous le rencontrez à l’hiver 1974 dans un club de Londres, le Speakeasy ?
Il était au fond du trou. Lemmy venait de se faire jeter de son groupe, les Hawkwind. Pourtant, il se pensait irremplaçable, le seul à pouvoir chanter aussi bien Silver Machine. On savait tous pourquoi il avait été viré : il avait traversé la frontière avec des amphétamines cachées dans son slip ! Cela lui avait valu un petit séjour en prison. C’est vrai que c’était stupide de sa part. Et il l’a reconnu. Mais, surtout, il attisait la jalousie au sein du groupe car c’est lui qui attirait toute la lumière. Personne, hormis John Entwistle des Who, ne jouait de la basse comme lui. Je l’ai ramassé à la petite cuillère. Il était catastrophé : toutes les autres places étaient prises.
Vous allez donc former Motörhead avec lui. Vous lui serviez d’infirmier ?
Ai-je tenu ce rôle ? Probablement ai-je été une béquille pour lui, comme je l’avais été pour mon père à la mort de ma mère. Lemmy avait compris que je pouvais lui être utile : j’avais une voiture, c’était nettement moins cher que le taxi ! Et puis, je ne l’emmerdais pas. Les histoires de mâles alpha qui se tirent la bourre, ce n’était vraiment pas son truc, il les évitait au maximum. Contrairement à l’image qu’on pourrait en avoir, c’était un homme possédant une grande vie intérieure. Très cultivé, il avait toujours un bouquin sur lui : des essais, de la philosophie et, bien sûr, des biographies de musiciens.
Votre livre décrit aussi toute une époque…
Dans les années 1960, on est passés du noir et blanc à la couleur. Le Swinging London a tout fait exploser. Mary Quant, David Bailey… On n’était pas surpris non plus de croiser les Rolling Stones dans la rue. Soudain, des Kinks aux Pink Floyd, tous les gamins de la classe ouvrière prenaient le pouvoir.
Ça sentait bon le patchouli, mais pas seulement…
Je n’ai pas voulu faire l’impasse sur la drogue. Si Keith Richards en parle à peine dans son autobiographie, Life, elle était dans tous les esprits. Combien de dealers le rock a-t-il engendrés ? Il me paraissait important d’en raconter les effets. Tout le monde en prenait à l’époque, et Lemmy plus que d’autres encore. Il jouait sous acide. Mais revenons à la génération qui nous avait précédés : il était tout à fait admis de prendre un apéro à 11 heures du matin. Ma mère allumait toujours deux clopes à la fois, une pour elle et une pour mon père. Et ça ne s’arrêtait plus de la journée. Je me souviens de voisins que nous avions : ils ne buvaient pas, ne fumaient pas et, comble de tout, étaient végétariens. Tout le monde les regardait comme des bêtes curieuses ! À notre tour, nous avons eu nos addictions. Le quotidien, c’était de se rouler un joint en se levant le matin. Et, en cas de coup de barre, on se faisait une ligne. C’était la norme, sauf que Lemmy a poussé le bouchon encore plus loin.
« On ne m’a pas reversé toutes mes royalties »
La mode chez les rockers était même d’arborer des insignes nazis !
Ce n’était pas seulement Motörhead. De Brian Jones à Siouxsie and The Banshee, se présentant avec une croix gammée en brassard, c’était de la pure provocation venant de groupes qui cherchaient avant tout à se distinguer. Déjà, sur le moment, je trouvais ça dangereux : mon père avait été un des premiers à s’inquiéter de l’accession d’Hitler au pouvoir. Mais, comme la drogue, je n’ai pas voulu éluder ce point dans mon livre. Nous appartenions à une génération abreuvée de récits de guerre et de victoires de nos aînés, on était complètement bassinés. On découvrait les crimes de guerre, il y avait le conflit au Vietnam. On s’est mis du côté des vaincus par pure provocation.
Vous-même, au bout d’un an, vous avez été remercié de votre groupe. Comment l’avez-vous vécu ?
Bien. Je suis un garçon loyal. Et je ne suis pas masochiste. Si on ne veut plus de moi, eh bien je pars. J’ai immédiatement tourné la page, mais j’ai été heureux que soit réédité notre premier album, On Parole, en 2019, avec mes prises de batterie. On avait fait du bon boulot. C’est cela qui a donné les bases de Motörhead.
Vous a-t-on versé vos royalties ?
Non. Ils me doivent un peu d’argent. Mais on a tous une dette à payer, non ?
Motörhead, in and out : entre autres histoires d’une vie exubérante, Lucas Fox – Hors collection, 366 pages, 21,90 euros.
Source : Lire Plus