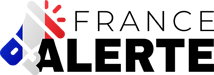Certes, il y a l’actualité et ce barrage retour de Ligue des champions contre le Benfica qui attend mardi (21 h sur Canal +) les Monégasques à Lisbonne après un inquiétant revers à Louis-II (0-1). Mais il y a aussi l’histoire, celle d’une institution unique dans le football hexagonal, qui fête son centième anniversaire, nantie d’un palmarès glorieux : huit titres de champion, cinq Coupes de France et deux finales européennes.
Arrivé adolescent de son Tarn natal, Claude Puel a disputé plus de 600 matchs (1979-1996) sous le maillot rouge et blanc, record absolu pour un joueur de champ. L’ex-milieu défensif a remporté deux championnats et trois Coupes puis un nouveau titre en L1 en tant qu’entraîneur, en 2000, avant de diriger des clubs comme Lille, Lyon, Nice, Leicester ou Saint-Étienne. À 63 ans, il est une personnalité incontournable de la vie du Rocher, membre des Barbagiuans, l’équipe caritative du prince Albert II. Son regard sur l’AS Monaco est unique, à la fois tendre, précis et un brin nostalgique.
Le JDD. Malgré sa défaite à l’aller (0-1), Monaco peut-il encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ?
Claude Puel. Oui, bien sûr, tout reste jouable. C’est vrai que le match aller a été décevant. Le contenu manquait de talent, les derniers gestes n’étaient pas bons. J’attends plus de Golovin ou de Minamino. Ce sont des joueurs qui doivent mettre leur empreinte sur ces matchs-là. Ça m’embête quand je vois des joueurs rencontrer des difficultés dans les contrôles, les passes, je n’ai pas eu l’habitude de voir ça depuis le début de saison.
« À nos débuts, il y avait moins d’argent, on vivait dans un sentiment d’appartenance et de fidélité »
Maintenant, l’arbitrage n’a pas aidé non plus. L’expulsion (du Monégasque Al-Musrati pour avoir mimé le geste du carton devant l’arbitre après une faute portugaise) est un détournement de la règle, qui est faite pour que les joueurs ne se jettent pas sur l’arbitre, lui crient dessus, le bousculent. Là, il était à plusieurs mètres, il a juste fait un geste… C’est regrettable pour le football et pour l’équité de la rencontre.
La suite après cette publicité
L’AS Monaco vit la saison de son centenaire, l’événement passe presque inaperçu…
Il a été fêté en principauté, c’était réussi, mais cela n’a pas eu l’envergure méritée, c’est vrai. Cent ans, c’est quand même fou. Monaco fait partie de l’histoire du championnat de France avec cette particularité d’être le club d’un pays. Je trouve ça extraordinaire.
Qu’est-ce qui définit l’AS Monaco avant tout ? Le beau jeu ?
Il y a toujours eu ici de très grands noms avec une recherche d’esthétisme, de technicité. C’était encore plus marquant quand l’ASM pouvait se permettre d’attirer les meilleurs joueurs de la planète. Heureusement, l’apport du président Rybolovlev lui permet encore de le situer honorablement sur la scène internationale. Il faut aussi parler du centre de formation qui a fourni beaucoup d’internationaux, à toutes les époques.
Jean-Luc Ettori, gardien de but aux 755 matchs, et vous-même comptabilisez plus de 1 300 rencontres à l’ASM, l’unique club de votre carrière commune. Un chiffre quasi inimaginable aujourd’hui. Avez-vous un jour pensé partir ?
À nos débuts, il y avait moins d’argent, on vivait dans un sentiment d’appartenance et de fidélité. J’ai connu les agents de joueurs à partir de 26-27 ans. C’est là que le foot-business a vraiment démarré. Moi, je jouais pour Monaco, c’était impossible de m’imaginer ailleurs, de me dire « tiens, ce serait sympa d’aller dans tel ou tel club ».
« Chaque saison, l’ASM recrutait des internationaux à mon poste et je finissais par m’imposer »
J’étais tellement obnubilé par l’idée de défendre les couleurs, de me mettre minable pour gagner les matchs, d’être le meilleur à l’entraînement… J’avais pourtant des sollicitations, avec Tapie à Marseille ou Borelli au PSG. Chaque saison, l’ASM recrutait des internationaux à mon poste et je finissais par m’imposer. L’appartenance, ce n’est pas se laisser vivre, c’est se battre pour gagner sa place ou pour la garder. Et Monaco, c’est mon pays. Je suis ici chez moi.
Vous avez joué dans l’ancien stade Louis-II, qui était une enceinte à nulle autre pareille…
C’est vrai (sourire). Le zoo était installé juste derrière un but. Pendant les matchs, on entendait parfois l’éléphant qui barrissait ! C’était devenu la mascotte du club, il s’appelait Bouba. Il n’y avait qu’une seule grosse tribune latérale, le reste était ouvert. Quand je suis arrivé au centre de formation en 1977, Monaco venait de remonter dans l’élite. Avec le même effectif, le club allait devenir champion de France directement.
On montait sur le toit au-dessus du secrétariat et on regardait les matchs. Je me souviens d’un Monaco-Nice avec des joueurs extraordinaires, les Moizan, Jean Petit, Onnis, Gardon, Dalger… Un an et demi plus tard, je devenais l’un des premiers gamins du centre à débuter chez les pros avec Lucien Leduc. Il n’y avait que deux remplaçants à l’époque, c’était très dur de se faire une place dans l’équipe. Je n’avais pas été très bien accueilli. Aujourd’hui, on reçoit les gamins, on leur montre le chemin… Cela n’a plus rien à voir.
Vous avez assisté à l’éclosiond’un entraîneur qui allait devenir l’un des plus influents de sa génération, Arsène Wenger…
Le président Campora avait misé sur lui alors qu’il venait de descendre avec Nancy en D2, ce qui est quand même très fort. À son arrivée en Angleterre en 1996, un journal avait titré : « Arsène who ? », (« Arsène qui ça ? »). On aurait déjà pu le faire à Monaco en 1987. Il en imposait déjà avec peu de mots. Il a apporté aux entraînements une nouvelle dimension. Avant, tout reposait grosso modo sur le talent. Là, on mettait en place un système, on se bonifiait. Je l’ai eu sept ans comme entraîneur, ça n’a pas toujours été simple.
Quand il est arrivé, j’étais titulaire depuis deux ou trois ans. Il m’a immédiatement remis en question. J’ai demandé des comptes, parfois un peu vertement. Et puis j’ai cherché à savoir ce que je devais changer pour regagner ma place. J’ai arrêté de dribbler, j’ai épuré mon jeu en axant sur la récupération et la transmission du ballon vers ces joueurs extraordinaires qu’étaient Glenn Hoddle ou Enzo Scifo. Grâce à ça, je ne suis plus sorti de l’équipe. C’est Arsène qui m’a permis de mener cette réflexion. Mais il ne m’a pas montré la voie, c’est moi qui ai tiré les leçons de ma situation, ce que tous les joueurs ne font pas forcément. Quand je suis devenu entraîneur, j’ai tenu à donner à tous mes joueurs des axes de travail et de progression.
Adi Hütter, l’entraîneur actuel, s’inscrit-il dans l’héritage de l’AS Monaco ?
Je discute parfois avec lui et Thiago Scuro, le directeur général. C’est bien qu’il ait prolongé, cela donne une certaine stabilité. J’ai aimé la saison dernière durant laquelle il a permis aux individualités, dont celles que je citais tout à l’heure, de bien s’exprimer. Avant son arrivée, ils étaient tout en délicatesse, le jeu n’était pas assez épuré et certains éléments qui manquaient de technicité n’avaient rien à faire là.
« En France, à part le PSG, il faut vendre pour vivre »
Ils se sont remis à combiner en marquant de beaux buts. Il n’a pas hésité à faire confiance à des jeunes comme Akliouche ou Ben Seghir. De moins en moins d’entraîneurs prennent le risque de lancer des jeunes venant du centre de formation, c’est très important.
Monaco a été battu trois fois par le PSG cette saison. Cette ultradomination depuis bientôt quinze ans n’est-elle pas frustrante pour un club comme l’ASM ?
Ce n’est pas évident, en effet, même si Monaco a été champion en 2017. Cette saison-là, le club avait réuni de super joueurs qu’on a retrouvés dans tous les grands clubs d’Europe, les Mbappé, Fabinho, Lemar… Pour réussir, il faut être hyper fort dans le recrutement et obtenir une cohésion totale avec de la qualité à chaque poste. Monaco peut le vivre par séquences, mais pas sur la durée ; à un moment donné, il faut vendre des joueurs pour retrouver une assise financière et parier sur d’autres.
J’avais vécu ça en 2000, on avait été champions avec un effectif très jeune, les Christanval, Sagnol, Trezeguet, Léonard… Pour en revenir à Paris, ils ont la capacité de garder les joueurs pendant des années malgré les transferts et les salaires astronomiques. Ça leur donne une cohésion. En France, à part le PSG, il faut vendre pour vivre, et certains clubs font n’importe quoi : ils vendent quinze joueurs à l’intersaison et en achètent autant, sans se rendre compte que ça détruit tout.
Source : Lire Plus