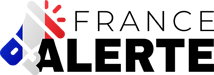La dernière fois qu’on s’était parlé, il nous avait traité de connard. Peut-être qu’à ses yeux, on s’était montré indélicat en parlant de ses fesses. C’était pourtant l’argument de sa dernière tournée. Reprenant l’affiche qui fit scandale en octobre 1972, avec son joli petit cul rebondi au nez des passants pour promouvoir sa « Polnarévolution » à l’Olympia, il en avait profité pour égrener ses classiques qui continuent de ne pas prendre une ride – contrairement à son postérieur ?
Comme on a du cul, nous aussi, il nous a pardonné et nous reçoit au bar du Trianon Palace, à Versailles, pour évoquer son dernier album, Un temps pour elles. Ce recueil intemporel de huit compos, alternant titres chantés et instrumentaux (Villa Cassiopée, Solstice), nous ravit en ce qu’il délivre ces mélodies que l’on n’espérait plus depuis son tube Goodbye Marylou (1989). S’ouvrant gracieusement sur Un temps pour elle, cet objet resserré nous fera rapidement oublier la tentative de retour esquissée avec l’album « Enfin ! » (2018). Et pas besoin de mettre des lunettes pour constater que ce disque contient au moins un hit, Tu n’m’entends pas, avant de poursuivre sa trajectoire tubesque (Quand y’en a pour deux) et de se clore sur un parfum eltonjohnien période Song For Guy (Un moment). À bientôt 81 ans, Polnareff redevient ce Prince en otage auquel nous avons été fier de consacrer un ouvrage. Prêt, Michel ?
Le JDD. Pourquoi sortir un nouvel album aussi rapidement ?
Michel Polnareff. Ça a été, disons, l’envie… Mais vous n’avez pas écrit un livre sur moi ? Un prince en otage, c’est ça ?
Oui.
La suite après cette publicité
Je l’ai lu ? [Il se tourne vers son manager, Serge Khalifa, coréalisateur d’Un temps pour elles, qui répond : « Je ne sais pas si tu l’as lu, mais tu l’as. Gentil, je ne sais pas, mais il est juste. Moi, j’ai bien aimé. »] Sinon, vous ne seriez pas là.
Merci, Michel, je suis content d’être encore en vie, grâce à vous. Revenons au disque. Qu’est-ce qui vous a motivé ?
[Polnareff recommande une flûte de champagne, la précédente étant devenue tiède.] J’ai d’abord renoué avec des auteurs français. Malheureusement, je n’ai trouvé aucun écho dans leur écriture. Donc j’ai décidé de me jeter à l’eau tout seul. J’en suis satisfait, mais c’est dur d’écrire soi-même. Vous le savez, ce n’est pas aussi simple que cela, vous qui êtes un écrivain renommé !
Pourtant, de Love Me, Please Love Me (1966) à Âme câline (1967), c’est un exercice qui ne vous est pas étranger. Ça vous est moins naturel que la musique ?
Non, mais c’est un effort que j’aime partager. Là, je ne trouvais personne pour co-dire ce que j’avais à dire. On est à un carrefour, le monde est incertain. Mon rôle, c’est d’enlever la gravité du moment. Tous les auteurs avec qui j’espérais travailler étaient trop près du sol.
Vos chansons s’inspirent-elles de l’actualité ?
Non. J’ai beau tout suivre des infos, je ne veux pas être dans le commentaire des derniers trucs que j’ai lus. Et si vous me posez la question, je suis totalement apolitique.
En même temps, votre album s’intitule « Un temps pour elles ». C’est votre côté féministe ?
Écoutez, moi, par principe, je n’aime pas les femmes qui n’aiment pas les hommes, comme je n’aime pas les hommes qui n’aiment pas les femmes. Chacun ses préférences sexuelles, bien entendu, mais nourrir la haine d’une race, c’est quand même très bizarre.
En même temps, par votre personnage androgyne, vous avez été l’un des premiers à faire bouger les lignes. Vous débarquez dans le paysage cinq ans avant Ziggy Stardust, de David Bowie (1972)…
Si je suis responsable de ça, j’en suis fier. Mais, sur le moment, je faisais plutôt les choses par instinct, sans trop réfléchir. Ma révolte devait résonner avec d’autres frustrations. Certains ont dû apprécier que je me batte pour eux. Je sentais bien d’ailleurs qu’on me suivait.
« Une chanteuse pour laquelle j’aimerais écrire : Lady Gaga »
Vous aviez cette voix de tête qui est devenue votre signature. Vous étiez unique en votre genre…
Ah si, en Amérique, il y avait un groupe qui chantait comme cela à l’époque ! Mais son nom ne me revient pas.
Curieusement, vous n’avez jamais écrit pour des femmes…
Je ne les empêche pas de me reprendre. Elles ont le choix dans mon répertoire. Il y a cependant une chanteuse pour laquelle j’aimerais écrire : Lady Gaga.
Quand on essaie d’isoler votre voix grâce à l’IA, sur Lettre à France (1972) par exemple, la machine la confond avec le solo de guitare tellement vous chantez haut…
C’est drôle, ça. Mais, à ce propos, il n’y a aucune intelligence artificielle sur l’album, juste pour le clip de Sexcetera.
Vous auriez dû écrire pour Wonder Woman, Lynda Carter…
Pas eu le temps, notre relation a été très courte, mais elle chantait très bien. Elle était venue chez moi, comme Emmanuelle. On habitait le même immeuble avec Sylvia Kristel. C’était une artiste formidable. Elle peignait. Elle m’avait pris comme modèle pour ses tableaux.
Maintenant, chacun est dans sa bulle. C’est le sujet de Tu n’m’entends pas…
J’en parlais déjà dans Goodbye Marylou. À l’époque, cela passait par le minitel. Aujourd’hui, c’est les smartphones. Mais cela reste des machines. Ce qu’on entend dans ce manque de communication énorme, c’est une inquiétude générale sur l’avenir du monde.
Vous en souffrez de cette solitude ?
Non. En tant qu’artiste, on est toujours seul, même quand on est accompagné. Personne ne comprend ce que vous faites. Il faut être fort et prêt à souffrir.
« Mes lunettes, maintenant, je les mets pour qu’on sache que c’est moi »
Mais vous ne l’étiez pas déjà quand vous travailliez à 20 ans dans une compagnie d’assurances ?
J’étais employé aux écritures. Bon, mon père [le musicien et compositeur Léo Poll, NDLR], ça le rassurait car j’avais la sécurité de l’emploi. J’avais eu beau m’être tapé huit heures de piano par jour, avec un premier prix de conservatoire à la clé, il n’a jamais été aussi heureux que de me savoir dans une banque. Probablement était-il jaloux de moi. Il avait peur que je le dépasse. Pourtant, il était un bon musicien, un bon pianiste de jazz. Mais je détestais cette boîte. Alors je suis devenu chanteur de rue. C’est dur, la rue. Il faut survivre. Mais cette force me permet d’être encore là.
Vos lunettes vous ont-elles servi d’écran pour vous protéger de votre succès fulgurant ?
Dans la rue, en effet, je ne les avais pas alors que j’étais déjà myope. Mes lunettes, maintenant, je les mets pour qu’on sache que c’est moi. J’en ai un peu marre de les porter parfois. Mais c’est pratique quand on me cherche : il suffit de suivre les lunettes. C’est un bon signal.
Pendant le confinement, on a vu des artistes paniquer à l’idée de disparaître. Vous n’avez cessé de le faire tout au long de votre carrière. N’êtes-vous pas surpris que le public soit toujours là quand vous revenez ?
Non, car je pense que je fais partie de la culture française. La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais je ne disparais jamais vraiment, sinon, vous ne seriez pas là. Quand je réapparais, c’est pour vérifier que je suis encore vivant.
Actuellement en tournée et le 14 juin à l’Accor Arena de Paris.
Source : Lire Plus