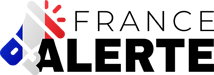Le JDD. Au début de votre livre, Mon antiracisme, publié aux éditions Desclée de Brouwer, vous racontez votre propre expérience du racisme. Quand y avez-vous été confronté pour la première fois ?
Kévin Boucaud-Victoire. C’était vers mes 9 ans, juste avant la Coupe du monde 1998, d’ailleurs célébrée autour du slogan « Black-Blanc-Beur ». Lors d’une embrouille, un camarade de classe m’a lancé : « Ma race est supérieure à la tienne. » Son père était d’origine espagnole et sa mère algérienne. Ça a été un événement marquant pour moi. Plus tard, durant mon adolescence, j’ai subi des insultes du même genre, des « sale Noir », des cris de singe…
Vous confiez avoir feint de croire, lorsque vous étiez plus jeune, que le racisme n’était que « l’apanage des Blancs, des vieux colons ». Aujourd’hui, vous avez un avis différent.
Plusieurs facteurs entraient en compte. D’abord, je m’intéressais à l’histoire, principalement à l’esclavage et à la colonisation. À l’époque, le Front national émergeait et, bien que le vote Le Pen ne pût se réduire à cette question, cela pouvait donner l’impression, à un jeune Noir de cité comme moi, qu’il existait un racisme important en France. L’imaginaire américain – le rap, les séries, la société multiculturelle… – contribuait aussi à ma vision du racisme centrée sur une prétendue domination blanche.
Mais en grandissant, j’ai été témoin d’autres formes de racisme. J’ai vu des Blancs traités de « jambon-beurre » ou de « faces de craie », des Africains et des Arabes s’insulter, des Noirs se rejeter entre eux… Quand j’habitais en Guyane, il y avait des Noirs locaux qui s’en prenaient aux immigrés surinamiens ou brésiliens. C’est ainsi que j’ai compris que personne n’a le monopole du racisme.
La suite après cette publicité
Vous écrivez : « Il m’aura suffi de m’habiller différemment pour ne plus subir de contrôle de police, ou presque. » Qu’entendez-vous par là ?
En fréquentant l’Université, les bibliothèques, certains milieux professionnels, j’ai compris que tous les Noirs et les Arabes n’étaient pas confrontés aux mêmes réalités. Ceux qui venaient de milieux plus aisés ne subissaient pas, ou peu, de contrôles « au faciès ». Diverses enquêtes l’attestent : c’est une question de codes sociaux, de style vestimentaire, d’attitude… pas seulement de couleur de peau. Le profil ciblé par les forces de l’ordre, c’est surtout celui de la « caillera ». En gros, l’archétype du jeune de cité.
Vous notez que le racisme, au sens biologique du terme, a chuté, mais que l’« insécurité culturelle » augmente. C’est-à-dire ?
D’après les enquêtes d’opinion, environ 8 % des Français croient encore qu’il existe une hiérarchie entre les races. Des discriminations demeurent, et ce pourcentage reste non négligeable, mais il est minime par rapport à la place que la question occupe dans le débat public. En revanche, l’« insécurité culturelle », souvent perçue comme du racisme, à tort, a explosé.
« En France, le racisme systémique n’existe pas »
Cette notion, notamment théorisée par le fondateur du Printemps républicain, Laurent Bouvet, désigne la crainte de voir son mode de vie et sa culture disparaître. Cette insécurité touche aussi bien les autochtones, qui voient la société changer à une vitesse inédite (mondialisation, numérisation, immigration…), que les immigrés, qui veulent garder leur culture d’origine à tout prix par peur de trahir leurs racines en vivant « à la française ». Le résultat ? Une société où l’intégration républicaine ne fonctionne plus.
Vous décrivez l’impasse à laquelle aboutissent les deux courants antiracistes dominants. Le premier est incarné par des associations comme SOS Racisme.
C’est celui que je qualifie de libéral, hérité du « touche-pas-à-mon-potisme ». Même s’il est aussi politique, cet antiracisme se fonde sur la morale. En somme, « le racisme, c’est mal. » Il combat les discriminations, mais il cherche surtout à intégrer les minorités au capitalisme, à insérer de la diversité au sein des élites. Avec ce courant, la lutte antiraciste est devenue un produit marketing et même un « spectacle » (pour reprendre l’expression de Guy Debord), entre concerts géants remplis de célébrités et campagnes publicitaires comme celles de Benetton.
Le second, c’est l’antiracisme décolonial, aujourd’hui majoritaire et repris par des partis comme La France insoumise.
Je l’appelle aussi antiracisme identitaire. Il est incarné par l’ex-porte-parole du Parti des indigènes de la République, Houria Bouteldja, ou encore par le comité Adama. Il est communautariste et utilise lui-même la notion de race, au sens « social » du terme. Mais il ignore les réalités du capitalisme en rapportant constamment tout au passé colonial, jugeant que les structures d’hier expliquent intégralement celles d’aujourd’hui. Cet antiracisme-là valorise les cultures minoritaires de façon essentialiste, et sa lutte se focalise sur le « racisme d’État », en niant toutes ses formes individuelles.
Or si le racisme systémique a pu exister, avec la colonisation ou la ségrégation aux États-Unis, il ne décrit clairement pas la réalité de la France d’aujourd’hui. Il y a des personnes noires ou d’origine maghrébine au sein des classes dominantes, tout comme il y a beaucoup de Blancs très pauvres. La mobilité sociale est faible pour tout le monde. Enfin, en réalité, elle est actuellement plus forte en Seine-Saint-Denis que dans la Creuse.
Vous évoquez également le racisme anti-Blancs, nié par les mouvements antiracistes actuels. Quelle est votre position ?
Ces mouvements ont tort de vouloir donner une définition du racisme qui s’éloigne du sens commun. Pour la plupart des gens, c’est tout simplement haïr quelqu’un en raison de sa couleur de peau ou de ses origines. Il est évident que cela peut viser les Blancs. J’en ai parfois été témoin. En revanche, selon moi, ce racisme n’est pas majoritaire et résulte principalement d’une réaction – qui peut être très violente – à un sentiment de domination ou à l’histoire coloniale.
Pour sortir de l’impasse, vous proposez une alternative. À quoi ressemblerait-elle ?
L’universalisme rejette l’assignation à résidence identitaire, l’idée que les groupes sociaux déterminent nos destins. La lutte des classes oppose ceux qui possèdent les moyens de production à ceux qui ne les possèdent pas. Il faut bâtir un front commun entre tous les opprimés autour de ces deux piliers. François Ruffin, avec sa « France des bourgs » et sa « France des tours », veut réunir classes populaires rurales et urbaines. Mon idéal, c’est cela, et plus encore : une société autogestionnaire, horizontale, où tout le monde a voix au chapitre.
Source : Lire Plus