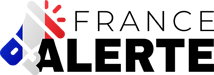«Jusqu’ici tout va bien. » La formule culte de La Haine résonne aujourd’hui comme une ironie tragique. Car pour Mathieu Kassovitz, tout semble aller pour le mieux… tant que l’on se moque des « Français de souche ». L’acteur-réalisateur a donc récidivé. C’était hier. Après avoir décrété qu’ils n’existaient plus, il les a renommés, hilare, « fins de race ». Comprenez : des reliques condamnées à disparaître dans le grand bain du métissage obligatoire. Derrière ce sourire béat, une vision sinistre : celle d’un monde sans racines, sans transmission, sans mémoire.
Kassovitz dit tout haut ce que croit une frange de la gauche culturelle : qu’il faut dissoudre les identités pour atteindre une paix universelle fantasmée. Mais l’antiracisme de cour de récré a viré à l’obsession raciale. L’individu ne vaut plus que par ses origines.
Le plus inquiétant ? Ce racialisme se dit progressiste. Il essentialise les peuples, hiérarchise les brassages, nie le droit d’aimer ses racines. Le Français de souche devient suspect par nature. Et l’insulte glissée en direct sur un plateau télé n’indigne que les « mauvais esprits ». Il fallait oser. Kassovitz l’a fait.
Mathieu Kassovitz appartient à cette caste d’artistes gavés de subventions
En réalité, il n’a jamais aimé les Français. Il les observe comme des entomologistes dissèquent des fourmis : de loin, avec un mélange de fascination et de dégoût. Mathieu Kassovitz appartient à cette caste d’artistes gavés de subventions, qui méprisent jusqu’à la moelle le peuple qui les a faits. Le Français moyen ? Une gêne, une tache, une « fin de race ».
On ne découvre pas Kassovitz. Rappellez-vous : en 2020, il regardait droit dans les yeux Véronique Monguillot, veuve du chauffeur de bus massacré à Bayonne, et lui expliquait, le plus froidement du monde, que la mort de son mari était un fait divers, que c’était comme ça, et que ça arriverait à d’autres. Cette morgue tranquille, cette violence déguisée en lucidité, c’est sa marque. Il se croit courageux. Il est juste cruel.
La suite après cette publicité
Chez Kassovitz, le bon peuple est trop blanc, trop enraciné, trop franchouillard. Alors on le traîne dans la boue, on lui colle des étiquettes, et on rit de sa lente extinction. Dans l’impunité la plus totale.
Kassovitz ne parle pas en son nom seul. Il incarne un courant – minoritaire mais bruyant – qui rêve d’une société liquide, sans repères, sans mémoire. Pour ces idéologues du déracinement, l’héritage est une maladie, l’identité un danger, la nation une fiction ringarde. Il ne faut plus transmettre, mais déconstruire.
Ce qu’il appelle « mélange inévitable », c’est en réalité un effacement planifié. Une négation méthodique de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, de ce que nous pourrions redevenir. Il n’y a plus de Français, seulement des flux. Plus d’Histoire, seulement du mouvement. Plus de peuple, seulement des masses à reconfigurer. Voilà le rêve de Kassovitz. Et de tant d’autres.
Mais un pays n’est pas une salle d’attente ni un carrefour d’aéroport. Un pays, c’est une langue, une culture, une mémoire. C’est un récit commun. Et les nations qui survivent sont celles qui osent dire « nous ». Ce « nous » que Kassovitz hait, raille et voudrait dissoudre dans la lessiveuse du monde.
La vérité, c’est que les peuples ne disparaissent jamais tout à fait. Et qu’à force de les insulter, on finit par réveiller ce qu’ils ont de plus ancien : leur instinct de survie. Dans La Haine, Kassovitz écrivait : « Ce n’est pas la chute qui compte… c’est l’atterrissage. » Il devrait s’en souvenir. Car à force de mépriser la France, c’est lui qui risque de s’écraser.
Source : Lire Plus