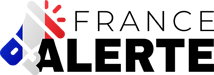Il y a 20 ans, à une large majorité, la France rejetait le projet de traité de Constitution de l’Union européenne. Treize ans après la bataille référendaire qui avait vu le « oui » l’emporter de peu en faveur du traité de Maastricht, les partisans du « non », mélange d’eurosceptiques, de souverainistes de droite et de gauche et de déçus de l’Europe, prenaient une revanche, certes indiscutable démocratiquement, mais discutée…
Le traité de Lisbonne signé en 2007 par les États membres de l’UE, soit quelques mois tout juste après l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, ratifié par le Congrès en 2008, vint infirmer le verdict pourtant sans appel des urnes qui, le 29 mai 2005, avait mis un coup d’arrêt à une construction techno-politique perçue comme se faisant dans le dos des peuples et contre la vertèbre de toute démocratie : la souveraineté populaire.
Que pointe in fine cet enchaînement dont le moins que l’on puisse dire est qu’il résulte d’un détournement décomplexé de l’esprit prévalant en démocratie ? Vainqueur dans les urnes, le décret populaire que la victoire du « non » avait acté fut défait par le biais de forces oligarchiques convaincues qu’elles détiennent le sens de l’histoire.
« Rarement la crise démocratique n’a été aussi aiguë »
La mécanique subreptice pouvait dès lors se mettre en mouvement : c’était en quelque sorte une révolution au sens astronomique qui opérait ainsi, autrement dit un retour à un point antérieur de l’Histoire, puisqu’en contournant la souveraineté populaire et en la détournant, ceux qui avaient pris l’initiative d’effacer par Lisbonne le « non » de la France procédaient à une occultation législative de la volonté de la majorité au profit de la volonté de la minorité.
Appelons cela comme on veut mais il s’agissait de facto d’un coup d’état silencieux qui ne disait pas son nom, mais qui renversait tous les considérants de la pratique démocratique tels qu’ils s’étaient forgés au cours d’au moins deux siècles de luttes politiques. Cette réalité politique s’indexait sur une réalité sociale que le débat référendaire autour du traité de Maastricht avait amplement soulignée : les catégories populaires, une grande partie des classes moyennes, les zones rurales et périurbaines, celles au profit de qui s’était échafaudée depuis au moins deux siècles l’architecture de la souveraineté démocratique, avaient majoritairement rejoint le camp de la défiance à l’encontre de l’UE.
La suite après cette publicité
Cette dernière, aux yeux de ces segments de l’opinion, incarnait non seulement l’entrée dans une mondialisation ouverte à tous les vents, mais également une mécanique de sécession où quelques-uns décidaient au nom de l’idée qu’ils se faisaient de leur intelligence de l’Histoire en lieu et place du plus grand nombre. En d’autres termes, le vote était démonétisé, dévalué, discrédité, dès lors qu’il ne validait pas la cité abstraite que l’UE, dans ces immeubles impersonnels de la Commission, entendait construire en dehors de toute mise en critique.
C’est à cette marche forcée d’un « néoprogressisme » élitaire, autoritaire comme vient de le définir récemment le philosophe Marcel Gauchet dans un entretien accordé au Figaro, que correspond le « non » au non de 2005. Depuis, toute une entreprise de containment des répliques nationales à l’échelle européenne de cette insurrection par les urnes n’a cessé de se développer ; souvent avec succès, comme en France à plusieurs reprises avec le surgissement du macronisme et du « bloc central » ; parfois avec moins de réussite, en témoigne entre autres en Italie l’expérience Meloni.
Il n’en demeure pas moins que vingt ans après l’étrange victoire du non de 2005, rarement la crise démocratique n’a été aussi aiguë, prenant la forme d’une délégitimation des formes historiques du concept démocratique au nom d’un habillage qui se veut démocratique, mais qui ne l’est plus que dans les mots, et dont les actes traduisent la sortie préoccupante du contrat politique qui a généré la relation pacifique des gouvernants aux gouvernés. En prenant le risque de trancher celle-ci, les premiers, non seulement défient les seconds, mais engagent progressivement nos sociétés dans une voie de grande instabilité. On n’a pas fini de subir les effets du déni de 2005…
*Arnaud Benedetti est rédacteur en chef de la Revue Politique et parlementaire et professeur associé à l’Université Paris Sorbonne.
Source : Lire Plus