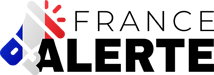Le JDD. François Bayrou a annoncé un « plan de retour à l’équilibre des finances publiques qui va demander un effort à tous les Français ». Mais les Français sont réticents à voir leurs impôts augmenter puisqu’ils constatent la dégradation continue des services publics. Comment expliquer celle-ci ?
Philippe Nemo. Elle est due au fait que le secteur public n’ayant cessé de s’étendre ces dernières années, une grande partie de l’argent public est dépensée par des centaines ou des milliers de décideurs non coordonnés et dont aucun n’a une vue d’ensemble. Chaque responsable veille à maintenir les emplois et les revenus de son secteur et n’a plus trop le temps de songer à l’intérêt général. Les ministres disent eux-mêmes aujourd’hui que le système est hors de contrôle. Par exemple, tout le monde semblait d’accord sur le fait de diminuer, ou du moins de stabiliser, le nombre de fonctionnaires. Or on constate que ce nombre a continué d’augmenter cette année, et que la masse salariale qui y correspond a gonflé de quelque 6 %. Il n’y a plus de pilote dans l’avion.
Comment en est-on arrivés là ?
À la Libération, les communistes nous ont fait le beau cadeau de créer un statut de la fonction publique et, dans les entreprises publiques et privées, un régime de conventions collectives, qui n’ont pas d’équivalents ailleurs en Europe. Donc, dans de vastes secteurs de la vie économique française, il y a une rigidité des salaires et des statuts qui empêche tout management rationnel. Les statuts collectifs gomment la diversité des situations individuelles. Ils empêchent d’adapter la rémunération de chacun à l’efficacité de son travail et de réallouer les ressources humaines de façon efficiente.
La puissance syndicale dépassant celle de tout gouvernement, à chaque grève ou menace de grève, les dirigeants cèdent (ou du moins ont cédé avec un bel ensemble pendant des décennies), faisant payer aux contribuables les ressources supplémentaires indûment exigées par les corporations organisées. Avec le résultat que les membres de celles-ci sont rémunérés sensiblement plus que la valeur marginale réelle des services qu’ils rendent. Voilà pourquoi les dépenses publiques sont structurellement excessives et incontrôlables, et pourquoi, pour les suivre, il faut sans cesse augmenter les impôts.
La suite après cette publicité
Dans votre livre, Philosophie de l’impôt, vous expliquez que la mutation de la fiscalité après la Seconde Guerre mondiale a introduit une « inquisition fiscale ». Voit-on aujourd’hui les limites de ce modèle ?
Il fut un temps où l’impôt était conçu comme le paiement par les citoyens de services que leur rendait l’État. Il avait alors une limite : chaque année, on prévoyait tant de dépenses, on divisait cette charge entre contribuables, et après avoir payé son dû, le citoyen était quitte. Le reste de son revenu ou de son patrimoine restait sa propriété incontestée, l’État n’avait même pas besoin de les connaître. Mais, à partir du moment où, conformément aux idéologies socialistes, on a conçu l’impôt essentiellement comme un outil de redistribution, il n’y a plus eu de limites aux prélèvements.
« N’augmentons aucun impôt, et revenons à l’équilibre budgétaire par la seule diminution des dépenses »
Le propos du fisc et des organismes sociaux n’est plus de prélever telle somme définie pour financer tels services définis, mais de s’emparer d’un pourcentage arbitrairement décidé des revenus et patrimoines de chacun. Ils ont donc un besoin impérieux de les connaître intégralement et sans échappatoire. D’où l’inquisition fiscale. Elle a eu pour conséquence que l’impôt est désormais ressenti comme une prédation. Il est clair que si l’on va encore plus loin dans cette voie, c’est-à-dire si l’État français essaie de battre son propre record du monde des prélèvements obligatoires, le consentement à l’impôt diminuera comme peau de chagrin. Telle est en effet la limite du modèle.
Comment refonder notre modèle fiscal tout en favorisant la justice sociale ?
Si l’on ne veut pas que la justice sociale soit un fantasme orwellien, il faut une prospérité économique qui la permette. Or celle-ci est d’autant plus compromise que l’État prélève une part plus grande des richesses produites par la société. Il est désolant que la classe politique française soit encore si peu consciente de cette loi d’airain du socialisme. Regardons les pays riches : pas un d’entre eux n’est socialiste, pas un n’a un taux de prélèvements obligatoires comparable au nôtre. Il serait donc sage de suivre leur exemple.
N’augmentons aucun impôt, et revenons à l’équilibre budgétaire par la seule diminution des dépenses. Pour réduire celles-ci, la bonne voie n’est pas de supprimer des services publics à la tronçonneuse comme Javier Milei ou Elon Musk le font, mais de faire en sorte qu’ils coûtent structurellement moins cher. Pour cela, je crois qu’un jour prochain il faudra remettre en cause, sauf pour les fonctions véritablement régaliennes, le statut de la fonction publique et le régime des conventions collectives.
*Philippe Nemo est philosophe, spécialiste d’histoire des idées politiques. Il a publié Philosophie de l’impôt (PUF).

Source : Lire Plus